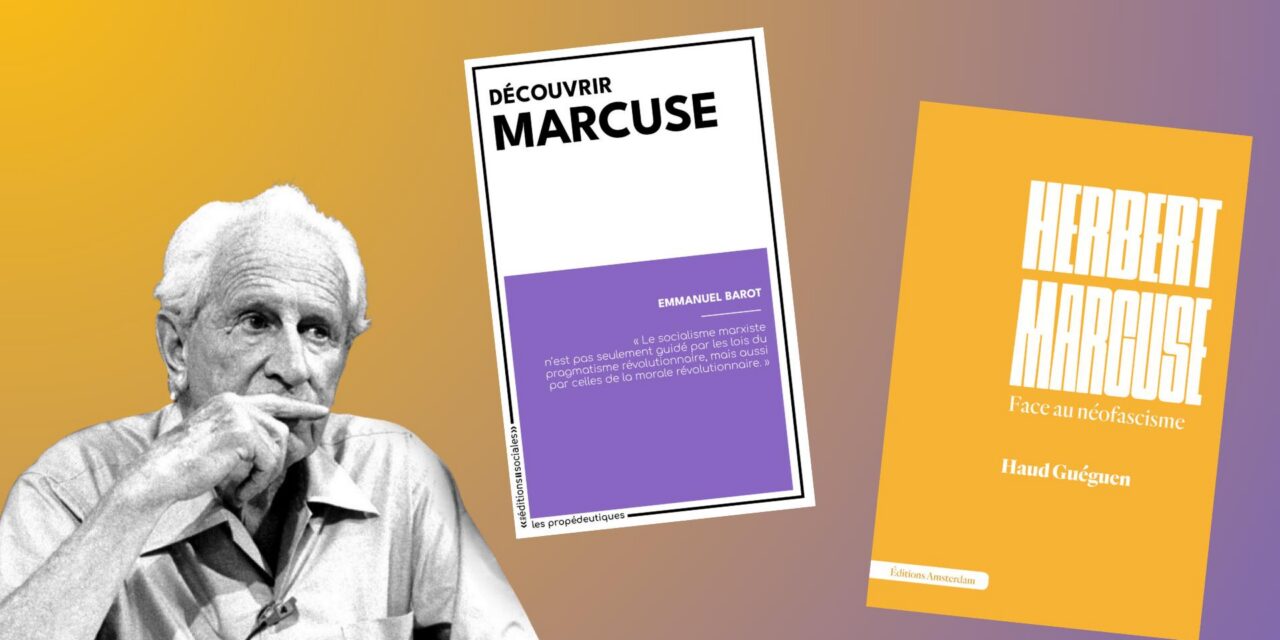« On ne doit pas réviser mais restaurer la théorie marxiste ; il s’agit de la libérer de son propre fétichisme, de la dégager de sa ritualisation, de la rhétorique pétrifiée qui bloque son développement dialectique », in Contre-révolution et révolte, p. 47.
La publication à quelques mois d’intervalle de deux ouvrages d’introduction(1)Voir : Haud Guéguen, Herbert Marcuse face au fascisme. Paris, Editions Amsterdam, 2025 et Emmanuel Barot, Découvrir Marcuse, Paris, Editions sociales, 2026. consacrés au philosophe allemand Herbert Marcuse, nous donne l’occasion de nous (re)plonger dans la pensée de cet auteur hétérodoxe, fidèle toute sa vie au marxisme et à la révolution. Erigé au rang de « père » des révoltes de 1968, il a été liquidé ensuite tant par la droite lors de l’offensive antimarxiste des années 1980 que par une gauche qui voyait dans son intérêt pour les questions affectives et culturelles l’expression d‘un idéalisme petit-bourgeois incompatible avec l’orthodoxie économiciste du moment.
Les périodes de crises (tant économique, sociale, écologique que théorique) constituent souvent des moments féconds pour (re)découvrir des auteur·ices moins (ou mal) connu·es de l’histoire des pensées de l’émancipation. C’est probablement ce contexte qui place aujourd’hui Herbert Marcuse sous la lumière de l’actualité éditoriale. Ces retours sont en général guidés par un souci légitime d’identifier ce qui, dans la vie ou l’œuvre de ces auteurs et autrices, peut nous permettre d’éclairer les problématiques de notre époque, et ceci sans anachronisme, puisque les penseurs et penseuses du passé ne peuvent évidemment jamais fournir une solution clef en main pour une époque qu’ils n’ont pas connue. Marxiste hétérodoxe, Marcuse va traverser une bonne partie du « court XXe siècle », produisant une œuvre riche et hétérogène, marquée par des préoccupations diverses et des déplacements dans sa pensée, mais s’appuyant sur une aspiration constante à penser les conditions objectives et subjectives de l’émancipation. J’identifie, de façon partielle et forcément sélective à partir de la lecture des deux ouvrages cités plus hauts, trois leçons que le penseur allemand nous offre pour nourrir un marxisme militant et utile pour le 21e siècle.
D’abord, une méthode résolument antidogmatique, qui considère la théorie marxiste non pas comme un manuel, mais comme une manière d’appréhender le monde dans ses contradictions, qui doit toujours s’ouvrir aux connaissances scientifiques contemporaines ainsi qu’aux nouvelles revendications qui émergent des luttes sociales; ensuite, une étude des extrêmes droites qui considère le phénomène fasciste non comme une anomalie de l’histoire, mais comme une virtualité immanente du libéralisme, et ceci sans lui dénier son caractère de discontinuité brutale avec le fonctionnement « normale » des démocraties capitalistes; enfin, une réflexion sur le rôle de la subjectivité, au sein des luttes et dans un monde post-capitaliste : si le libéralisme et le fascisme s’appuient nécessairement sur un appareillage pulsionnel pour se maintenir, une société émancipée ne pourra faire l’économie de la construction d’une « nouvelle sensibilité » qui doit se refléter aujourd’hui dans nos luttes. Ces trois « leçons » convergent vers un effort constant chez Marcuse de (re)définition du sujet révolutionnaire, qu’il ne considère pas comme un donné sociologique inscrit dans la structure de classe et les rapports de production, mais plutôt comme un projet de construction hégémonique qu’il faut sans cesse remettre sur le métier.
Parcours d’un marxiste hétérodoxe
Avant d’entrer dans le cœur de ces éclairages pour les militant·es d’aujourd’hui, il est nécessaire de donner quelques repères biographiques qui permettent de mieux saisir les préoccupations de Marcuse et l’évolution de sa pensée.
Après avoir cherché pendant ses études à construire une hybridation entre marxisme et heideggerisme, en articulant le matérialisme historique du premier à l’anthropologie du second, Marcuse découvre les Manuscrits économico-philosophiques de 1844, écrits par le jeune Marx en dialogue avec Hegel et l’école classique de l’économie politique anglaise, et publié de manière posthume en 1932. C’est un « moment décisif » dans la trajectoire du philosophe, comme le rappelle Emmanuel Barot, tant ces manuscrits constituent l’ébauche du marxisme anthropologique que Marcuse cherchait à construire. Celui-ci s’engagera ensuite auprès de l’Institut de recherche sociale de Francfort, mais s’en éloignera progressivement, sans rompre avec certaines thématiques-clefs de la théorie critique, notamment le rôle de la rationalité instrumentale dans la dimension destructrice du capitalisme, mais en conservant, à la différence de Horkheimer et Adorno(2)Voir : Stathis Kouvélakis, La critique défaite. Emergence et domestication de la Théorie critique, Paris, Editions Amsterdam, 2019, la révolution pour visée théorique et politique.
Avec l’arrivée au pouvoir des nazis, Marcuse s’exile aux Etats-Unis, où il passera la majeure partie de sa vie. Dans les années 1940-50, il cherche à doter la socio-histoire marxiste d’une épaisseur affective, et s’engagera dans ce projet à travers une lecture sélective de Freud. C’est ce travail d’historicisation les concepts issus de la psychanalyse qui constituera la charpente théorique d’Eros et civilisation. Marqué par l’expérience du fascisme qui s’appuyait sur une base de masse, l’objectif de Marcuse est d’une part de s’interroger sur les ressorts affectifs de la domination, pour comprendre comment les régimes autoritaires construisent le consentement des dominé·es, et d’autre part de réfléchir aux conditions pour édifier, par les affects, une subjectivité révolutionnaire. C’est notamment de cette période que Marcuse doit son inscription dans le courant freudo-marxisme, une constellation de penseurs qui ont cherché à hybrider marxisme et psychanalyse, bien que lui-même se soit explicitement éloigné de plusieurs auteurs phares de ce courant.
L’émergence dès la deuxième moitié des années 1960 de nouvelles luttes qu’on rassemblera sous le vocable « New Left »(3)Notamment les luttes pour les droits civiques, la deuxième vague du féminisme, la solidarité avec le Vietnam, les ébauches de luttes écologistes. marquera profondément Marcuse. Alors qu’il livrait en 1964 un diagnostic pessimiste dans L’Homme unidimensionnel, dans lequel il montrait la façon dont le capitalisme fordiste gouvernait également par les besoins, en produisant une série de besoins artificiels voire nuisibles pour mieux obtenir le consentement des dominé·es, il s’enthousiasme de l’apparition de ces luttes qui appellent à réformer la vie. Marcuse se réjouit de cette dynamique qui bousculent les partis et syndicats traditionnels, et qui semblent émerger des marges de la classe ouvrière. A cette époque, il ira jusqu’à considérer de manière trop unilatérale que ces nouveaux et nouvelles révolté·es éclipsent un prolétariat « traditionnel » désormais intégré au système par les sirènes de la consommation, et qui constituerait aujourd’hui une force de conservation et non de révolution. A sa décharge, il n’aura de cesse de nuancer son jugement dans les années à venir, en observant d’une part que cette intégration du prolétariat est beaucoup plus contradictoire, notamment selon les contextes nationaux, et en rappelant d’autre part que l’articulation entre mouvements sociaux et classe travailleuse au travers d’un véritable front uni était la clef pour des luttes victorieuses. A partir de cette période et jusqu’à la fin de sa vie, en juillet 1979, Marcuse n’aura de cesse d’entretenir une discussion critique avec cette nouvelle gauche.
Une méthode marxiste hostile à tout dogmatisme
La première « leçon » que je tire de Marcuse tient à sa manière de concevoir le marxisme comme un espace théorique ouvert et critique. Tout au long de sa vie, le penseur allemand a formulé une conception souple du matérialisme historique, en ne le réduisant pas à la seule infrastructure économique. Il rappelle que si la conception matérialiste de l’histoire place effectivement les phénomènes sociaux et historiques au cœur de la compréhension du monde, elle n’exclut pas l’influence potentielle des évènements politiques, culturels, affectifs sur le cours des évènements. Loin d’être un manuel ou un système clos, le marxisme constitue pour lui une méthode, une façon de comprendre la totalité à partir de la multitude des rapports mouvants et dialectiques qui la constituent. Ce faisant, une véritable posture marxiste doit s’atteler à actualiser, amender et critiquer la pensée de Marx et de ses successeurs, sans dogmatisme ni révisionnisme.
Sans juger des résultats de ses recherches, la tentative de trouver dans les concepts psychanalytiques les ressources pour expliquer, à partir d’une position matérialiste, les ressorts affectifs de la vie sociale s’inscrit dans ce projet d’un marxisme ouvert, et ne peut qu’être saluée. Si le désir ne flotte pas au-dessus de la réalité sociale, il ne peut non plus se déduire mécaniquement d’une analyse minutieuse des rapports de production, et cela doit obliger les marxistes conséquent·es à prendre au sérieux la question des motivations pulsionnelles derrière les individus et les groupes sociaux. Sans une telle conception, on s’empêche par exemple de comprendre comment le fascisme se maintient en s’appuyant sur une véritable base sociale.
Cet attachement à un marxisme ouvert à (re)construire perpétuellement, et son hostilité à toute pensée codifiée et ossifiée, qu’il attribue explicitement au stalinisme ambient, explique en partie l’isolement de Marcuse et la méconnaissance de son travail dans d’une partie de la gauche.
Le fascisme comme virtualité du libéralisme
L’un des traits qui dote la pensée de Marcuse d’une solide actualité politique est certainement sa conception du fascisme comme potentialité immanente du libéralisme, qui lui fera dire au lendemain de la fin de la Seconde guerre mondiale que le problème du fascisme n’était pas derrière nous. C’est un avertissement qui résonne évidemment avec notre présent. Le fascisme constitue pour Marcuse, comme l’écrit Haud Guéguen, une forme limite du libéralisme, un renversement de l’esprit libéral qui peut apparaitre comme une solution pour les classes dominantes pour résoudre les contradictions dans les situations de crise (d’hégémonie, dirait Gramsci). La force de la conception marcusienne est qu’elle évite de considérer le fascisme comme un accident de parcours, une anomalie dans l’histoire du capitalisme, sans éluder pour autant la nécessité de distinguer la discontinuité entre fascisme et libéralisme, évitant ainsi les errements stratégiques d’une partie de la gauche qui ne différencie pas le (néo)libéralisme du (néo)fascisme, au risque de confondre adversaires et ennemis existentiels : malgré sa critique féroce du libéralisme et de sa rationalité instrumentale, Marcuse ne perd jamais de vue qu’une société libérale laisse une « chance » pour la construction d’une société socialiste, au contraire de la brutalité fasciste. La conséquence pratique d’une telle conception est que la solution structurelle au processus de fascisation ne peut jamais simplement être une lutte défensive qui conduirait au retour aux institutions (néo)libérales, mais bien plutôt une révolution (éco)socialiste qui élimine les racines du problème.
Haud Guéguen fait de l’articulation entre révolution et l’idée de fascisme comme virtualité du libéralisme le nœud de sa relecture contemporaine de Marcuse. Elle montre de manière convaincante que les élaborations de Marcuse dans les années 1970 autour d’une « contre-révolution préventive » anticipe, sans la nommer, la dynamique néolibérale qui prendra son essor au lendemain de la mort de Marcuse. Elle inscrit ainsi la nuit néolibérale au cœur d’un processus de radicalisation-fascisation du capitalisme de la seconde moitié du 20e siècle, qui permet de comprendre la brutalisation actuelle du monde. S’il est difficile de la suivre complètement dans l’idée que le second mandat de Trump représenterait seulement une accélération-radicalisation de la logique néolibérale(4)La question de savoir si notre époque constitue une rupture avec le libre-échangisme au profit d’un (néo)mercantilisme ou d’un (néo)impérialisme, ou bien une radicalisation de la logique néolibérale excède largement le cadre de ce modeste article., il est en revanche indéniable que les décennies néolibérales ont préparé le terrain de la catastrophe en cours, en renforçant la dimension répressive de l’Etat et en démantelant progressivement les conquis de la classe ouvrière, produisant un désarmement de ses capacités de résistance.
En toute cohérence, la lutte contre la fascisation en cours ne peut donc se limiter à défendre le statu quo libéral. Si toute victoire en ce dernier sens est souhaitable et bienvenue, elle ne fait que différer le risque du fascisme. Actualisant le mot d’ordre de Rosa Luxemburg, Haud Guéguen conclut que notre époque est celle de l’alternative radicale : écosocialisme ou (néo)fascisme.
La subjectivité est un champ de bataille
Marcuse comprendra rapidement que le processus révolutionnaire ne peut se résumer à la résolution des contradictions entre forces productives et rapports de production, et à la prise du pouvoir politique par le prolétariat. Il observe que le capitalisme ne produit pas seulement une classe exploitée et opprimée, mais également un certain type de subjectivité, adapté à ses besoins : une personnalité concurrentielle et individualiste, qui fait du principe de performance la colonne vertébrale des différentes dimensions de l’existence. Il attache ainsi très tôt de l’importance à l’idée de production d’un « nouveau type d’être humain », qui doit déjà se déployer ici et maintenant, mais surtout lors du processus révolutionnaire et en aval de celui-ci(5)Les réflexions de Marcuse trouvent échos dans les problématiques du « mode de vie », qui se sont développées dans la Russie révolutionnaire post-1917. Voir : Léon Trotsky, Les questions du mode de vie, Paris, Les bons caractères, 2025. Les luttes pour l’émancipation doivent selon lui stimuler des affects de solidarité, du prendre soin, et les orienter vers la nécessité, pour qu’ils puissent se déployer dans toutes leurs potentialités, d’une rupture avec le capitalisme. Cette réflexion sur le développement d’une sensibilité nouvelle donne notamment une portée émancipatrice à l’art et à la culture, vecteur d’une telle sensibilité, sans se perdre comme d’autres dans l’illusion que la révolution pourrait être seulement esthétique.
C’est cet arrière-fond qui permet de comprendre l’intérêt de Marcuse pour les luttes de la nouvelle gauche, qui ne critiquent pas seulement l’exploitation et l’oppression, mais également l’aliénation qui règne dans la société capitaliste, et qui s’exprime aujourd’hui par le manque de sens rencontré par les travailleur·euses dans leur emploi ou par le sentiment d’être saturé de besoins inauthentiques et ainsi dépossédé de sa propre existence. Les revendications de cette nouvelle gauche doublent ainsi les exigences de lutte contre l’exploitation de celles d’une vie émancipée, et posent la question de la définition démocratique des véritables besoins. Pour Marcuse, la subjectivité est un champ de bataille, et la gauche révolutionnaire doit pouvoir articuler les revendications d’une vie bonne avec un programme résolument anticapitaliste, dirigé vers la refonte du système de production et des manières de gouverner collectivement nos existences.
(Re)penser le sujet révolutionnaire
Ces « leçons » convergent d’une certaine manière dans un effort constant de Marcuse pour (re)penser à nouveau frais le sujet révolutionnaire. Si l’on ne peut le suivre dans son jugement péremptoire sur l’intégration de la classe travailleuse au capitalisme fordiste (une idée qu’il n’aura de cesse lui-même de modérer), il faut saluer son refus de réduire le sujet de l’émancipation à la classe ouvrière conçue comme un démiurge de l’histoire. Sans liquider la place cardinale des travailleurs et des travailleuses (Marcuse fera de l’insuffisance des liens avec le prolétariat l’un des facteurs expliquant l’échec des révoltes de la New Left), il comprend rapidement que les questions de genre, de race, de nation ou de sexualité ne sont pas extérieures à la classe travailleuse. Par conséquent, la clef de l’émancipation réside dans une véritable politique d’alliance (de « front uni » disait-il, à la suite de Trotski), qui articulent ces différentes revendications autour d’un projet révolutionnaire dirigé contre l’exploitation et l’aliénation capitalistes. A l’heure où le danger fasciste menace la possibilité même de résistance, cette leçon vaut comme un avertissement.
Notes